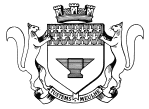Bouricos
Une petite anthologie
Les moines
Les religieux habitant le quartier de Bourricos ont pris le nom de “Fraternité de la Vierge des Pauvres”. On les appelle communément “les moines”. À leur arrivée, ils étaient démunis à peu près de tout bien matériel. L’outillage pour entretenir leur maison, travailler leur jardin, leurs champs etc. faisait complètement défaut. Il en était de même pécuniairement. Heureusement que des donateurs leur ont apporté les outils qui leur manquaient mais la pelle n’avait pas de manche, la scie avait besoin d’un sérieux coup de lime, la hache était très abîmée et très rouillée et le reste à l’avenant. Ils étaient donc toujours en panne et que faire ? On leur a conseillé d’aller voir le charron qui serait l’homme de la situation. Le frère Jérôme s’est armé de courage et m’a demandé si je pouvais quelque chose pour lui. Bien sûr, je n’ai pas refusé et après la journée, je lui ai mis son outillage en bon état. Le brave moine était très heureux et il a voulu me payer. Sachant qu’il n’était pas riche, je lui ai demandé de faire une prière pour moi, ce qui aura sans doute été fait et qui avait probablement une bien plus grande valeur que ce que j’aurais été en droit de lui faire payer. Voilà comment je suis entré en relations avec les moines de Bourricos qui ont continué à me mettre à contribution.
Quand le brave frère Jérôme avait vieilli et ne venait plus me voir, le frère Christophe l’a remplacé. Il bricolait tout le temps et venait souvent me faire affûter ses outils, il tenait absolument à me payer en monnaie de bon aloi. Sans doute le vieil homme qui avait beaucoup vécu, pensait-il que les biens matériels ont aussi leur valeur.
A. Bernède, le charron du village, dans un petit article de 1992
Serge, l’âne et la carriole
Du fond du village, un pas de mule ou de cheval fait résonner la chaussée, l’objet se précise vite, c’est une petite carriole vétuste, toute cahotante, presque honteuse d’être là, en pleine lumière, éclaboussée par tout le luxe des somptueuses voitures qui la croisent, qui la doublent, soulignant leur dédain, au passage, d’un bref coup de klaxon insolent et railleur. Elle avance pourtant sans hâte, suivant prudemment sa droite, tirée par un âne paisible dont pourtant les oreilles dressées en perpétuel mouvement, disent assez son dépaysement au milieu de tant de circulation et de bruit.
Près de lui, le tenant par la bride et marchant à son pas, un homme jeune (Serge Ndr) vêtu d’une robe grise serrée à la taille pat une ceinture... Son visage exprime la paix calme et sereine. Le regard clair est fixé devant lui. Ses lèvres, d’un mouvement à peine perceptible, murmurent les Ave Maria d’un chapelet lentement égrené de la main restée libre tombant le long du corps... C’est l’humble attelage de la Fraternité de Notre-Dame des Pauvres qui porte, à la colonie voisine, les produits du jardin progressivement défriché par ses moines.
Un anonyme [André Bernède -Ndr] dans le bulletin paroissial de Pontenx - septembre 1958
Connaissez-vous Trottoir-de-Bourricos et son heureux chef de gare ?
J’ai fait quatorze cents kilomètres de Paris à Trottoir-de- Bourricos et retour et je ne regrette pas mon voyage, puisque j’ai vu cette chose unique : une station de chemin de fer ouverte aux voyageurs une seule fois par an et que dirige un chef de gare qui sans surmenage évidemment, n’exerce ses fonctions que tous les trois cent soixante-cinq jours. Il gagne même une journée de repos tous les quatre ans, quand les années sont bissextiles.
Mais laissez-moi d’abord vous présenter Bourricos et son conjoint trottoir, situés dans le département des Landes.
Bourricos est si l’on peut dire, un pays qui détient le record de l’inexistence, étant modestement constitué par une chapelle — ouverte, elle aussi, une seule fois par an — et deux ou trois vagues habitations éparses aux alentours. Bourricos est la plus petite des agglomérations françaises; le Bottin lui-même ignore cette poussière de bourgade. C’est la localité de moindre étendue, dont les habitants — une dizaine, peut-être — doivent consti1ucr un peuple d’autant plus heureux qu’il n’a pas d’histoire et d’ailleurs, pas davantage de géographie.
Sauf sur la carte de l’État-major, on chercherait vainement dans toute notre cartographie nationale la présence de ce minuscule Bourricos constitué par des pins qui font un ombrage délicieux auprès d’une source aux abords moussus, dans le plus agreste des paysages.
Et, cependant, si l’on consulte l’indicateur Chaix, à la page 120, tableau K, de la Compagnie du Chemin de fer des Landes, on constate que Trottoir-de-Bourricos figure comme une station de la ligne de Labouheyre à Mimizan-les-Bains et qu’un train, un unique train, s’y arrête une fois par an, seulement le 24 juin.
Pour une gare si peu souvent en service, on a sans doute pensé qu’il était inutile de donner de nombreux renseignements aux touristes. On a donc omis d’indiquer, pour cette station, le prix, du transport et la distance kilométrique. Mais la compagnie du chemin de fer des Landes fait payer pour Bourricos le même prix que pour la station suivante. On ne saurait, d’ailleurs, acheter trop cher le droit de contempler la gare de Bourricos.
Quelle gare !
Pas de disques, de signaux, de sémaphore; ici, ni aiguillages ni plaques tournantes; on n’y entend ni timbre téléphonique ou télégraphique, pas plus que le tic-tac du morse ; pas de facteurs pour les bagages, pas d’employés à des guichets divers. Donc, aucune grève à craindre, nul sabotage à redouter.
Seul, à côté de la voie, sous les arbres et sans abri, avec le ciel bleu pour plafond et la terre verdurée pour parquet, M. Dubrana, chef de gare, assis sur une chaise, devant une table supportant une boîte fermée sur trois côtés, distribue aimablement des billets à ceux qui les lui demandent. C’est là tout le personnel et le matériel qu’emportera à la fin de la journée, le train de retour, de 5 heures 9 du soir et, billets, table, et chef de gare attendront jusqu’à l’année suivante avant de retourner à cette station improvisée. On dénomme officiellement cette gare « Trottoir », parce que la compagnie des Landes a fait remblayer légèrement un des cotés de la voie, afin que les voyageurs en descendant de wagon, ne courent pas trop le risque de se briser les jambes.
Le mois dernier, j’ai donc suivi la foule qui venait à Bourricos et par des sentiers bordés d’aubépines arborescentes, de bruyères en fleurs, de fougères aux feuilles étalées en ombelles, j’ai respiré délicieusement les odeurs de la forêt mêlées au parfum de cette résine qui en larges diamantées recueillies dans des cassolettes, s’écoule par les plaies largement ouvertes au flanc des pins géants. C’est dans cette contrée qu’autrefois ducs d’Albret et rois de Navarre, quittant leur résidence d’Albret, aujourd’hui Labrit, guerroyèrent et que le courageux Gaston de Foix surnommé Phébus à cause de sa blonde beauté et dont les exploits sont restés célèbres dans cette partie du Midi, tua, à l’épieu, sangliers, laies et marcassins, sur ces dunes landaises.
Chose curieuse, de temps immémorial, on se réunit à Bourricos le 24 juin, jour de la Saint-Jean. On y vient de vingt kilomètres à la ronde et, que le 24 juin soit légalement férié ou non, cette journée est décrétée fête chômée dans toute la région. Les usines licencient leur personnel, le travail des champs est suspendu dans la contrée et petits ou grands sont heureux de se rendre à Bourricos qui reçoit, en ce jour, la visite de cinq à six mille habitants des environs. Car, fait à signaler, en dehors d’un rayon ne dépassant pas le département des Landes, Bourricos et son meeting annuel sont complètement ignorés des populations du sud-ouest.
Bourricos doit certainement le maintien de sa renommée locale à ce fait que l’excursion peut être, au gré de chacun et selon ses convictions, religieuse ou profane. Car c’est à la fois un lieu de dévotion et de plaisir: on s’y donne rendez-vous pour prier ou pour s’y amuser. Du matin au soir que dure cette kermesse, les cinq ou six mille visiteurs sont libres de se purifier dans une eau réputée miraculeuse ou de folâtrer au bal champêtre installé non loin de la chapelle.
Certaines jeunes filles du pays savent, du reste, fort bien concilier les divers sentiments qui les animent : elles commencent par profiter des joies de la danse et terminent leur journée par la purification. De telle sorte que Dieu et le diable y trouvent chacun leur compte selon les heures de la journée.
Parmi les excursionnistes, les uns se rendent à Bourricos à pied, d’autres en charrette ; ânes, chevaux, mules et mulets sont mis à contribution dans toutes les fermes des environs et dès l’aube, les attelages les plus divers sont remisés dans la forêt où cet assemblage de carrioles forme un campement des plus pittoresques.
Le train, le fameux train unique, qui part de Labouheyre pour arriver à Bourricos à 2 h 52 de l’après midi et en repartir à 5 h. 9 — les 2 heures et 17 minutes d’existence du chef de gare de cette station — ce train bondé apporte, lui aussi, un sérieux contingent de voyageurs : ceux de la ville, les plus pressés.
La foule, qui arrive dès la pointe du jour et qui s’en retournera le même soir, trouve ce qui lui plaît dans ce lieu de réunion, pèlerinage, marché et foire tout à la fois.
Voici les auberges en plein vent avec leurs rudimentaires tables de bois on y apaise sa faim avec de la solide soupe de « garbure » ou de la tête-de veau aux œufs durs. Ceux qui ont soif y boivent de l’eau gazeuse panachée de bière. Dans les baraques, installées très sommairement pour cette fête d’un jour, on trouve toute l’habituelle petite industrie foraine: bonneterie, quincaillerie, confection, sellerie, chaussures, bourrelerie, porcelaine, jouets, bimbeloterie, instruments d’agriculture, confiserie, vêtements, charcuterie, vieux cuirs.
Cafés, chevaux de bois, cirque, tir aux pigeons, toute la petite industrie foraine s’est également donné rendez-vous en cet endroit. Entre temps, on va « faire un tour » à la vieille chapelle consacrée à saint Jean-Baptiste, dans laquelle le curé de Pontenx officie toute la journée, ou bien se laver à la source.
Cette source est captée dans une sorte de petit puits carré placé en contrebas et qu’entoure un bosquet formé d’arbres et d’arbustes.
C’est autour de ce quadrilatère de verdure que s’agenouillent les croyants. Les uns s’humectent les mains à l’eau de cette fontaine, d’autres s’y lavent la figure. Certains font provision du liquide aux qualités déclarées surnaturelles.
Quant à connaître exactement les vertus attachées à cette eau, c’est assez difficile. Tous ceux qui imbibaient une partie quelconque de leur corps et que j’ai interrogés sur les propriétés curatives de la source m’ont répondu : —Elle enlève les maux. — Quels maux? — Les boutons que l’on a ou que l’on peut avoir dans l’année.
Une légende religieuse s’attache donc à cette fontaine, mais personne ne la connaît dans le pays, pas même le clergé local que j’ai questionné à ce sujet, et qui m’a déclaré que les manuscrits relatifs à la piscine de Bourricos se trouvaient à Londres, où ils avaient été emportés lors de l’occupation de la Guyenne par les Anglais, vers le XIVe ou le XVe siècle.
C’est possible.
Mais qu’importe, après tout, que nos amis de la Grande-Bretagne soient ou non détenteurs des documents concernant l’eau de cette source ! « Pourvu, comme me le disait un habitant de Labouheyre, que ceux qui croient aux vertus de la source soient guéris, c’est kif kif Bourricos ». Il n’y a jamais que la foi qui sauve…
NOS LOISIRS, 30 juillet 1911 (pp.1022-1023)
L’Assemblade de Bourricos
Per Sent-Yan de Bourricos (1),
Mey de trente, den un bros,
De bone hore, a l’escurade,
Que s’en ban à l’assemblade,
Per ana bùbe à le hount,
Et prega lou sent patroun.
L’un qu’a gahat le yàunisse,
Sus le lane, chens le prisse ;
L’àut que cride d’un cachàu,
« Ah ! moun Diu, coum me hey màu... ».
Mé dap l’aygue benedite,
Le gran fièbre et le petite,
Touts bous maus, l’amne dou cos
Que s’en ban à Bourricos...
Mé bous atis, meynadotes,
Auta fresques que flourotes,
Dap àu cap, un foulart blanc,
Que bat ha dounc, en cantan,
Càussades dap espartilles ?
« A Sent-Yan, mindya cerilhes... ».
Pour Saint-Jean de Bourricos,
Plus de trente, dans un bros,
De bonne heure, à l’aurore,
S'en vont à l’assemblade,
Pour aller boire à la fontaine,
Et prier le saint patron.
L’un a attrapé la jaunisse,
Sur la lande, sans sa pelisse ;
L’autre se plaint d'une dent,
« Ah ! mon Dieu, comme ça me fait mal... ».
Mais avec l'eau bénite,
La grande fièvre et la petite,
Tous vos maux, nom de nom,
À Bourricos s’en vont...
Mais vous autres, jeunes filles,
Aussi fraîches que fleuries,
Avec un foulard blanc à la tête,
Qu'allez-vous donc faire, en chantant,
Chaussées d'espadrilles ?
« À Saint-Jean, manger des cerises... ».
(1) Bourricos : quartier de Pountens-les-Forges. Hount miracoulouse de Sent-Yan. Lous lanusquets qu’y anèbent, d’àuscops, en bros, lou 24 juin, per croumpa pelhots, et per se diberti ; mé sustout per mindya cerilhes. Lous malàus qu’anèn y bùbe l’aygue de le hount’ ou s’y bagna.
= Bourricos : quartier de Pontenx-les-Forges. Fontaine miraculeuse de Saint-Jean. Les hommes de la lande y allaient, autrefois, en bros, le 24 juin, pour acheter des habits, et se divertir ; mais surtout pour manger des cerises. Les malades allaient y boire l'eau de la fontaine ou s'y baigner.
Le gros péché du moine de Bourricos.
Lo pecadilhàs deu monge de Bourricòs.
Sus la lana de Pontens, au bordalat de Borricòs, plan coneishut per las soas cerilhas, un monge que s'avè apitat l'ermitatge.Que’s passava lo temps a pregar lo Bon Diu deu matin au ser, e que vivè de las aumóinas qui'u hasèn los poblants deu vesiatge. E qu'èran abondosas tant la soa reputacion de sent òmi èra grana sèt lègas adarron.
Aquò ne hasè pas briga los ahars deu Griput, lo gran diable de l'in?hèrn. Digun dinc adara n'avè podut resistir a las soas tentacions. Solet, lo monge de Borricòs que semblava bravejà’u, e lo Griput que'n disè sovent : « Malaja ! ». Que's sentiva abaishat dens lo son trabalh de diable, e lo Bon Diu, trufandèc, ne mancava pas de l'ac har arremercar.
Un jorn, totun, que n'estó hart. Que pugè en çò deu Bon Diu e, hèra enmaliciat, que miacè de l'ac copar tot pr'aquí en haut, se ne'u deishava pas la possibilitat de har pecar au mensh un còp lo monge. « Pr'un sol còp, ce's disó lo Bon Diu, que pòdi plan balhar aqueth plaser au Griput. Lo monge ne n'entrarà pas mensh au Paradís ! » E que permetó au diable de deishar har un pecadilhòt au monge de Borricòs.
Hèra urós, lo Griput que devarè au bordòt deu sent òmi, e que'u trobè, com tostemps, encuentat a pregar. Que'u condè autanlèu lo prosei qui vienè d'aver dab lo Bon Diu, e la permission obtenguda. Bon princi, que'u deishè tanbenh a causir entre tres pecats qui hasón jumpar de hastialetat lo monge piós : « Tua un òmi, emberiaga't, o lavetz desondra ua hemna deu vesiatge… A tu de causir !… »
Lo monge alavetz que's pensèc, entre tres maus, qu'un òmi sensiat e's devè de causir lo mendre. Que demandè donc a emberiagà's. Lo diable que'u balhè ua pisharra d'aiga de vita qui, per nòste, aperam armanhac. E que'u comandè de se la pintar còp sec. Lo monge qu'ac hasó en grimacejar, puish que se n'anè estujar, vergonhós, dens lo con?hin lo mei escur de l'ermitatge. Entà banlèu, los uelhs que se’u hiquèn a lusir d'un esclat inacostumat, que perperegè, lo nas que l’arrogè puish que blavegè, lo dit meninon que'u tremolegè, pensadas agradivas que'u boleguèn au cap… e que cantassegè medish ua cançon palharda entenuda dens la joenessa.
En aqueth enterhèit, la hemna deu vesin, un boscalhèr deu piadar, qu'èra vienuda portar, com de costuma, lo de-que-minjar au monge. Eth que voló l'arrecompensar e que'u balhè dus potoàs tapatjós sus las maishèras. Que s'eslurrè deu costat deus pòts, que se la sarrè a la cinta, que'u farfalhè la pelha… e que cadón sus la palhassa deu sent òmi… on la natura e's hasó l'òbra ! Lo Griput que se n'arridè com un tistèth, que’vs pòdetz pensar que quiò !…
Quan lo boscalhèr ne’s vedó pas tornar la hemna, que se n'anè se la cercar en çò deu monge. En la véder au lheit dab eth, que voló har aus patacs. Lo monge qu'ensagè de's defénder. Que's gahè a paupas, sus la taula, lo cotèth de copar lo pan. Que truquè com un òrb… e qu'escanè l'òmi !
Qu'es atau que lo monge de Borricòs, en créder de har un pecadilhòt, ne hasó tres a l'encòp. E pr'amor d'aqueth gran pecadilhàs, n'a pas jamés pujat au Paradís… Ne pòdi pas tanpauc dise'vs lo son nom : n'es pas estat escrivut dens nat calendari… e per causa !
Honts : L'inspiracion d’aqueth conde que me n'es vienuda en legir lo segond « brasèr » deus Evangèlis deu diable. Un còp de mei, l'Enric Gogaud que l'a hicat a la soa saussa dens L'arbe d'amor e de saviesa (edicions Le Seuil, 1992). Mes la mia version qu'es localizada dens la lana de Pontens las Hargas.
M. B.
Le gros péché du moine de Bourricos.
Sur la lande de Pontenx, au hameau de Bourricos, bien connu pour ses petites cerises sauvages, un moine avait installé son ermitage.Il passait son temps à prier le Bon Dieu du matin au soir, et il vivait des aumônes que lui faisaient les habitants du voisinage. Et elles étaient abondantes tant sa réputation de saint homme était grande à sept lieues à la ronde.
Cela ne faisait pas du tout les affaires du Griffu, le grand diable de l’enfer. Personne jusqu’alors n’avait pu résister à ses tentations. Seul, le moine de Bourricos semblait le braver, et le Griffu s’en désespérait souvent. Il se sentait rabaissé dans son travail de diable, et le Bon Dieu, moqueur, ne manquait pas de le lui faire remarquer.
Un jour cependant, il en eut assez. Il monta chez le Bon Dieu et, très en colère, menaça de tout casser par là-haut, s’il ne lui laissait pas la possibilité de faire pécher au moins une fois le moine.
« Pour une seule fois, se dit le Bon Dieu, je peux bien donner ce plaisir au Griffu. Le moine n’en entrera pas moins au paradis ! » Et il permit au diable de laisser faire un tout petit péché au moine de Bourricos.
Très heureux, le Griffu descendit dans la petite cellule du saint homme, et il le trouva, comme toujours, occupé à prier. Il lui rapporta aussitôt la conversation qu’il venait d’avoir avec le Bon Dieu, et la permission obtenue. Bon prince, il lui laissa aussi le choix entre trois péchés qui firent sursauter de dégoût le moine pieux : « Tue un homme, enivre-toi, ou alors désonhore une femme du voisinage… A toi de choisir !… »
Le moine pensa alors que, entre trois maux, un homme sensé devait choisir le moindre. Il demanda donc à s’enivrer. Le diable lui donna une dame-jeanne d’eau de vie que, par chez nous, nous appelons armagnac. Et il lui recommanda de la boire d’une seule traite. Le moine le fit en grimaçant, puis il alla se cacher, honteux, dans le coin le plus obscur de l’ermitage. Bientôt, ses yeux se mirent à luire d’un éclat inaccoutumé, il battit des paupières, son nez rougeoya puis bleuit, son petit doigt se mit à trembloter, des pensées agréables lui passèrent par la tête… et il fredonna même une chanson paillarde entendue dans sa jeunesse.
Sur ces entrefaites, la femme du voisin, un bûcheron de la pinède, était venue porter, comme d’habitude, son repas au moine. Celui-ci voulut la récompenser et lui donna deux gros baisers tapageurs sur les joues. Il glissa du côté de ses lèvres, il la serra à la taille, il farfouilla sous sa robe… et ils tombèrent sur la paillasse du saint homme… où la nature fit son œuvre ! Le Griffu en riait sous cape (comme un panier), vous pouvez l’imaginer sûrement !...
Quand le bûcheron ne vit pas revenir sa femme, il alla la chercher chez le moine. En la voyant au lit avec lui, il voulut se battre. Le moine essaya de se défendre. Il attrapa à tâtons, sur la table, le couteau à pain. Il frappa à l’aveugle… et il égorgea l’homme !
C’est ainsi que le moine de Bourricos, en croyant faire un tout petit péché, en fit trois à la fois. Et à cause de ce très gros péché, il n’est jamais monté au paradis… Je ne peux pas non plus vous dire son nom : il n’a jamais été inscrit dans aucun calendrier… et pour cause !
Sources : L'inspiration de ce conte m’est venue en lisant le deuxième « brûlot » des Evangiles du diable. Une fois de plus, Henri Gougaud l'a mis à sa sauce dans L'arbre d'amour et de sagesse (éditions Le Seuil, 1992). Mais ma version est localisée dans la lande de Pontenx-les-Forges.
M. B.
© Miquèu Baris – N’am traversat nau lanas – Lo gran pecat deu monge de Borricòs – Estiu de 1991
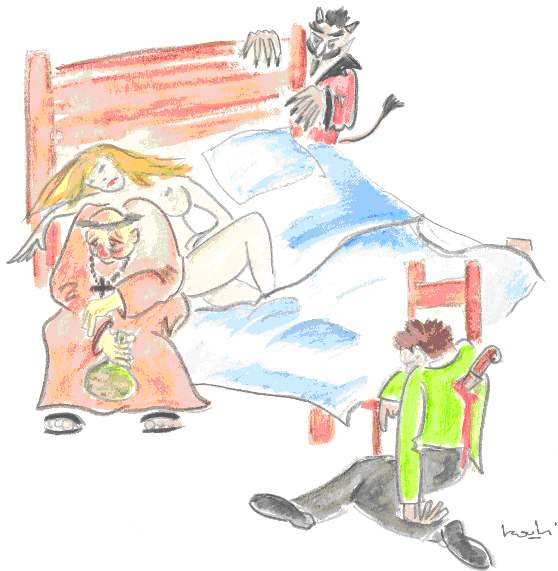
Illustration : © Nicolas Darriet, surnommé « Kouki ».
Bibliographie :
Habitants de Pontenx / Saint-Jean-de-Bouricos a besoin de vous !, tract ronéotypé, 2 p., octobre 1955
Une heureuse initiative - La remise en état de la chapelle de Bouricos , Bull. de la Soc. De Borda , 1955 , p. 144
Élie Menaut : Notice historique sur Bouricos , Bull. de la Soc. De Borda , 1955 , p. 146-149
Élie Menaut : Le culte des fontaines dans les Landes , Bull. de la Soc. De Borda , 1960 , p. 413-419
Élie Menaut : Rencontres de jadis, foires-pélerinages d’aujourd’hui… , Bull. de la Soc. De Borda , 1964 , p. 99-103
C. Lacoste : Fontaines consacrées… , Bull. de la Soc. De Borda , 1965 , p. 63-76, 173-186, 271-285,427-436
O. de Marliave, Sources et saints guérisseurs des Landes de Gascogne, L’Horizon chimérique, 1992
Dupuy Fontaines guérisseuses dans la grande Lande, Autrement, 1990
Pierre Meaule Bouricos : Hier… aujourd’hui, Bulletin des amis de Marquèze, n° 1, 1983
J.-P. Lescarret Fontaines consacrées et saints guérisseurs
Lavaud, Rituels de guérison et fontaines thérapeutiques, Mémoire d’éthologie, Bordeaux II , 1986